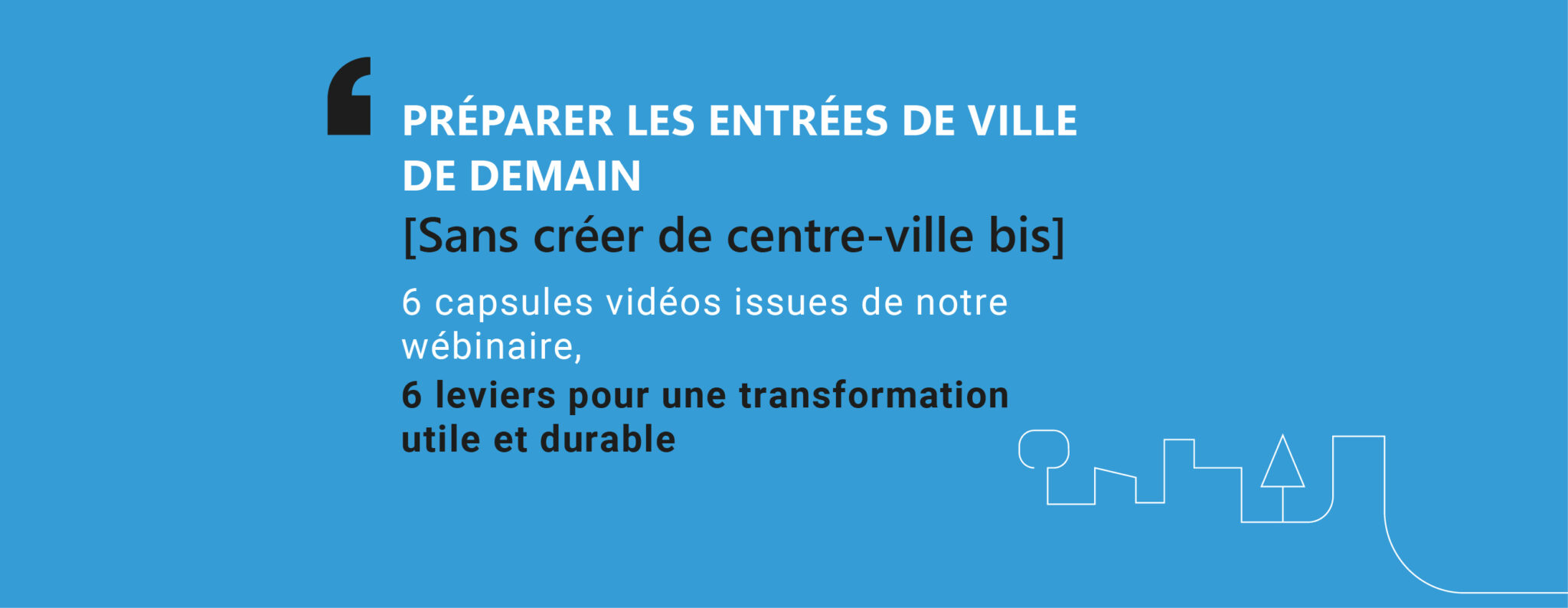Une réinvention stratégique, pas un copier-coller
A travers les missions que nous menons à La Rochelle, Montpellier, Pornic, Barentin, Bourg-en-Bresse ou encore Valence, nous partons d’un partir pris : les entrées de ville sont devenues des réserves stratégiques à mettre au service de l’intérêt de général selon les besoins d’un territoire et pas de la seule rentabilité d’une opération.
Pour prolonger la réflexion partagée lors de notre webinaire du 18 mars, nous avons extrait 6 capsules vidéo. Elles illustrent 6 clés de compréhension pour repenser les entrées de ville.
🛋️ #1. Un changement de modèle commercial qui redessine les entrées de ville
Decathlon qui réduit ses surfaces, Casino qui revend ses magasins par centaines, plus de 60 enseignes de prêt-à-porter qui ont disparu des galeries commerciales : tous les totems de la consommation et du commerce qui sont venus structurer nos zones commerciales de périphérie sont aujourd’hui largement chahutés. Même Caddy dépose le bilan. Le symbole est puissant : quand 40 % des Français vivent seuls, à quoi bon un Caddy pensé pour la famille standard des années 80 ?
Qu’est-ce que ces changements majeurs révèlent ? Ce n’est pas une crise, mais bien un changement de modèle social, un changement des modes de consommation, qui touche les entrées de ville.
📊 #2. Une offre commerciale saturée
Depuis 10 ans, la courbe est sans appel :
📈 +26 % de surface commerciale créée entre 2012 et 2021
👥 …pour une population qui, elle, n’a pas suivi cette dynamique.
Résultat ? Une offre commerciale disproportionnée par rapport à la demande, une saturation du marché.
Cela nous pose une question centrale : Comment réinventer les entrées de ville sans reproduire les excès du passé ?
🏢 #3. Quel rôle pour la collectivité dans la transformation des entrées de ville ?
La vraie question à se poser est peut-être la suivante : À quoi va servir notre périphérie à l’heure d’un changement sociétal majeur ?
📍 Car il faut le rappeler : nos zones commerciales n’ont cessé de se réinventer depuis les années 70, du totem de l’hypermarché à l’entrée de ville de destination, de loisirs dans les années 2000.
Et elles l’ont fait sans que la collectivité n’y investisse de l’argent.
Alors aujourd’hui, faut-il que la puissance publique porte la transformation des entrées de ville ? Et si son rôle, demain, c’était de gérer intelligemment l’usage du foncier, plutôt que d’accompagner un modèle privé en fin de cycle ?
🌆 #4. Entrées de ville : attention à ne pas créer de centre-ville bis ?
Nous pouvons tous constater un phénomène de plus en plus fréquent : des entrées de ville qui commencent à ressembler au centre-ville. Des rues piétonnes reconstituées, des façades alignées, un lieu de destination réinventé…
Alors oui, requalifier la périphérie peut être utile. Mais encore faut-il que cela s’inscrive dans une armature urbaine cohérente, et non comme un copier-coller d’un centre-ville déconnecté de la centralité.
⏳ #5. Mutation des entrées de ville : peut-être va-t-on trop vite ?
Oui, il faut réinventer la périphérie. Oui, il faut sortir du tout-commercial. Mais encore faut-il penser la transformation à l’échelle du temps long, avec une boussole claire :
– Quels sont les besoins en foncier de notre territoire à l’horizon 2035, 2040 ?
– Quelle est la juste place des opérateurs dans cette trajectoire ?
🛠️ #6. Transformer n’est pas (seulement) aménager
David Lestoux met en lumière un point essentiel : la transformation des entrées de ville ne peut pas se résumer à un plan de voirie ou à un projet d’aménagement immédiat.
Fixer un cap à 2040, c’est poser une stratégie, une vision pour le territoire. Ne nous trompons pas entre la stratégie et l’opérationnalité. Transformer la périphérie, c’est d’abord prendre le temps de réfléchir à ce qui est juste, utile et faisable pour le territoire.
C’est de cette manière que nous pourrons réinventer les entrées de ville de demain sans penser comme hier.
Les entrées de ville sont à la fois un symptôme et une opportunité. Le symptôme d’un modèle épuisé. L’opportunité de produire autre chose : de la mixité, du lien, des activités compatibles avec les enjeux territoriaux.
Pour cela, il faut être exigeant. Ne pas céder à la précipitation. Ne pas reproduire les modèles passés. Et poser une vision claire, à 10, 15 ou 20 ans pour imaginer la ville de demain sans penser comme hier.